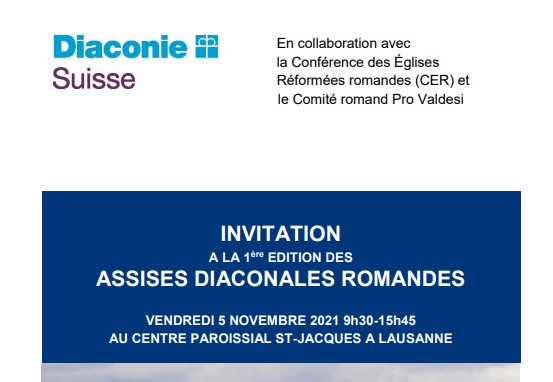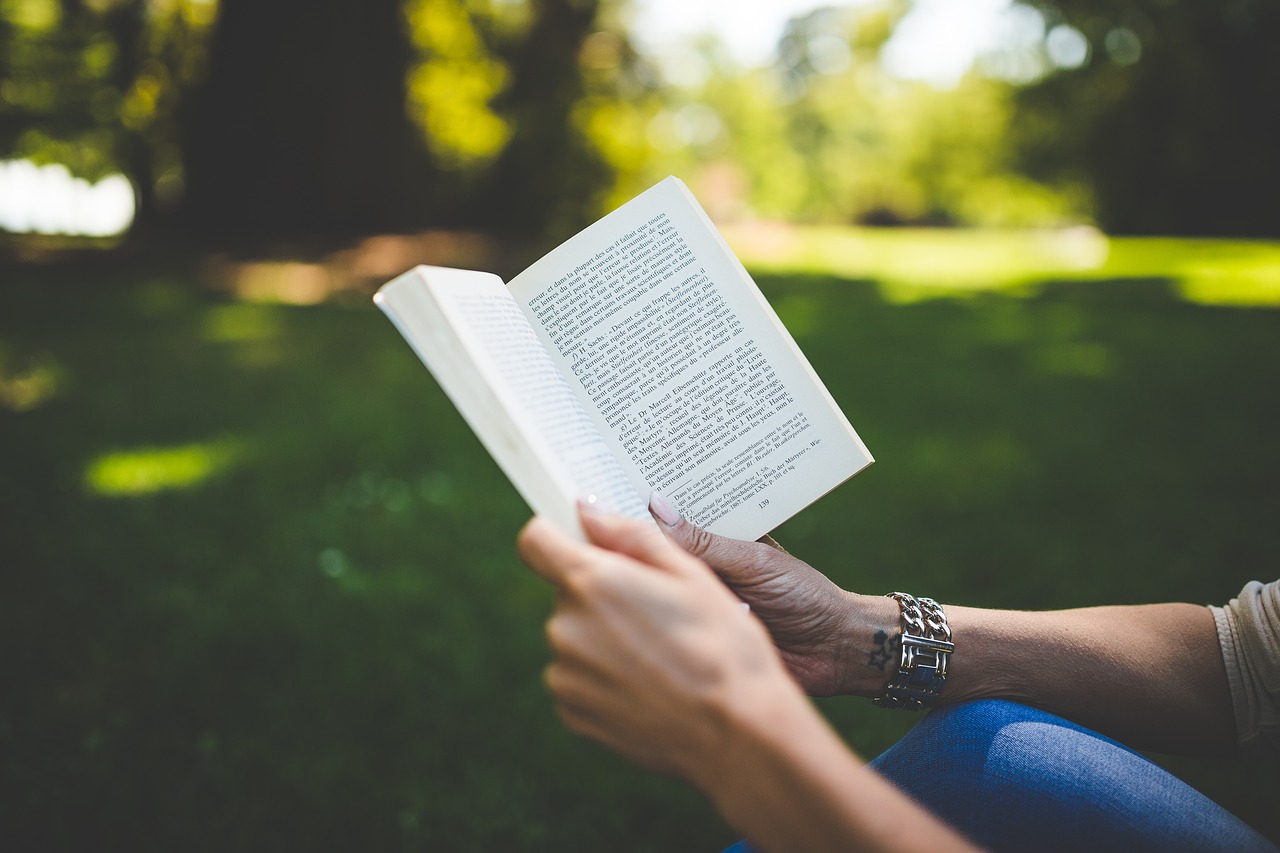Relancer la diaconie en Suisse romande. Poser de premiers jalons. Se retrouver autour d’une table ronde pour partager expériences et rêves à l’échelle de la Romandie. Voilà quels étaient les buts des premières Assises Diaconales Romandes mises sur pied par le département Projets et Pratique de Diaconie Suisse qui se sont déroulées à Lausanne le 5 novembre dernier.
Une vingtaine de participant·es ont répondu à l’invitation lancée par Diaconie.ch, et plus précisément par Mmes Jacqueline Lavoyer-Bünzli et et Liliane Rudaz-Kagi, toutes deux membres romandes et bilingues de Diaconie Suisse et co-organisatrices de la journée. Parmi l’assistance, nombre de diacres venant des Églises francophones y compris celles de Suisse alémanique, mais aussi des pasteurs et théologiens, des laïcs engagés et intéressés.
Voir le programme de la journée : Assises Diaconales Romandes (1re édition).
La rencontre s’est ouverte sur une conférence de Mme Trotta, modératrice de l’Église vaudoise du Piémont. À entendre tout ce que porte cette Église minoritaire et à vocation profondément diaconale, au service de la population, on en est presque jaloux. Jaloux, de notre timidité, de notre petitesse, de nos moyens, de nos ressources. Mais est-ce bien d’être jaloux ? Ne devrait-on pas plutôt s’inspirer de ce qu’accompli cette Église et de l’adapter à notre mesure ? Mieux encore, rêver une Église diaconale, ou plutôt des Églises diaconales en Suisse, avec notre spécificité forcément plurielle. Les échanges qui ont suivi la conférence, traduite en direct, ont été nourris et stimulants.
Rêver l’Église
Des discussions en groupes se sont voulues ouvertes au rêves pour nos Églises, pour la diaconie, pour nos engagements. Mais, on le constate assez vite: si on est invité à rêver, la réalité de notre présent nous limite forcément. Soit on coupe (un peu) l’élan, pour retomber sur le manque de moyens et de ressources, les limites du possible et des envies… Et on ne rêve plus! Soit, on fait abstraction du réel, et on se convainc que cela restera du rêve !
Lors du partage en plénum, une remarque fuse : « Merci, mais il me semble que cela fait longtemps qu’on dit cela… Et pourtant, rien n’a vraiment changé ! » Constat réaliste s’il en est! Mais cela n’interdit pas de faire bouger les choses là où nous sommes, de nous inspirer de ce qui se fait (déjà) ailleurs, de réfléchir ensemble.

Une couleur romande
On est aussi tombé d’accord pour constater que Diaconie Suisse, si elle a déjà beaucoup travaillé sur des projets et des concepts, ceux-ci correspondent à une vision « alémanique » du service au prochain, avec des spécificités que la Suisse romande ne connaît pas forcément. Cela résonne d’autant plus pour moi qui travaille à temps partiel dans la partie francophone de l’Église bernoise.
S’il y a bien l’Association diaconale romande qui devait jouer ce rôle de plateforme d’échange et de promotion de la diaconie de ce côté de la Sarine, force est de constater que cette association est sur le point de disparaître sous sa forme actuelle, pour rejoindre, sans doute, Diaconie Suisse, avec un vrai intérêt et un vrai engagement à la vision romande de la diaconie. Les organisatrices de cette journée s’y sont engagées.

Et maintenant ?
Souffler sur les braises pour rallumer le feu (sacré), c’est bien. Mais que faire pour que le feu ne s’éteigne pas à défaut de l’entretenir ? Une rencontre annuelle pourrait devenir la norme, avec un thème différent à chaque fois. On évitera aussi de multiplier les séances de travail, car nous avons tous des agendas débordants.
Un projet nous est présenté, celui des communautés bienveillantes ou caring communities. Il s’agit de la mise en commun bienveillante d’individus, d’acteurs sociaux, politiques, associatifs, paroissiaux qui s’unissent pour prendre soin de petites communautés à l’échelle d’un quartier, offrant aides, soutiens, attention et ressources aux besoins exprimés des personnes. Si je comprends bien la démarche, il ne s’agit plus d’être dans l’offre de prestations (prenez ce que nous vous proposons), mais à l’écoute des besoins de la base pour y répondre de manière coordonnée et ajustée (dites-nous ce dont vous avez besoin). Une paroisse pourrait, par exemple, s’inscrire dans un tel projet en mettant à disposition des locaux (salle de paroisse, cure), des bénévoles (visiteurs et visiteuses), des événement conviviaux (repas, rencontres)…
Nous sommes repartis reconnaissant·es d’avoir pu vivre des retrouvailles avec des collègues plus ou moins proches, plus ou moins connus; d’avoir pu lier contact. Reconnaissants aussi que la Suisse romande ne soit pas oubliée dans les réflexions et délibérations de la faîtière Diaconie Suisse; de pouvoir compter sur les engagements et les voix de Jacqueline et Liliane pour rappeler que nous existons.
Lire : l’article de Lucas Vuilleumier de ProtesInfo : Le « faire » et le « care » si nécessaires.
Le présent et l’avenir de nos ministères sont entre nos mains, mais pas que. Il y a bien évidemment les Églises et paroisses qui nous emploient. Il vaut sans doute la peine de leur rappeler que la diaconie n’est pas une option. Il y a nos partenaires, les bénévoles notamment, qui portent aussi la diaconie au travers de leur soin porté et tourné aux autres. Il y a aussi et surtout Celui qui nous accompagne au jour le jour dans nos engagements, Celui en qui nous mettons notre confiance et notre espérance. Sans tomber dans la naïveté, je crois qu’à Dieu seul la gloire!